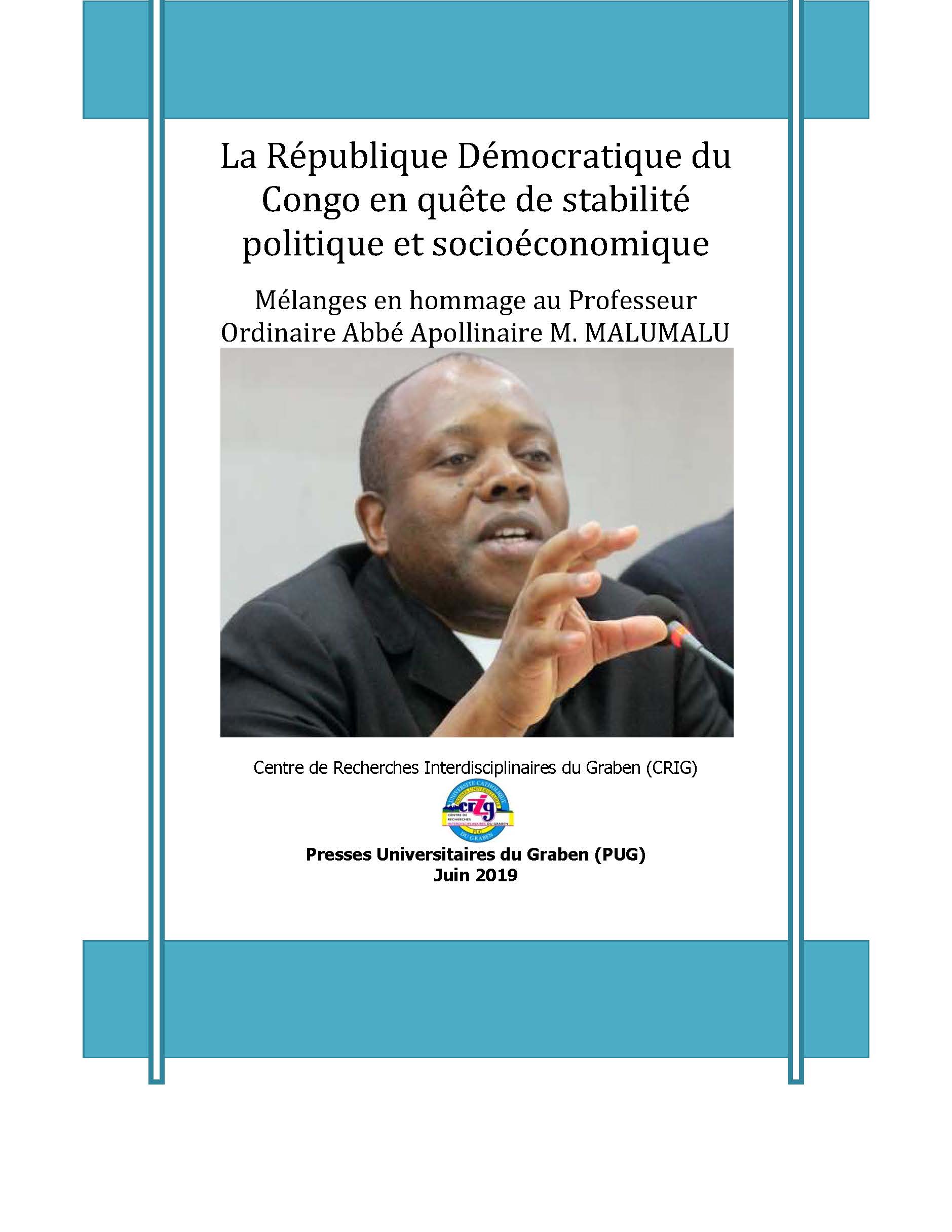La culturalité des droits humains
Résumé
Depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme le 10 décembre 1948, les droits humains sont sortis de leur portée nationale pour prétendre à l’universalité. En effet, jusqu’à cette date, les droits humains faisaient surtout l’objet d’affirmation et de défense par des textes nationaux. Cette universalité des droits humains a suscité de vives critiques, en Occident comme dans les autres parties du monde, qui les ont non seulement adoptés, mais aussi adaptés à leurs réalités socioculturelles. En adoptant des textes régionaux et sous-régionaux, les pays non-européens ont fait plier les droits de l’homme à leur manière de voir, en continuité avec leurs idéologies, leurs valeurs autochtones, leurs traditions, leurs économies, leurs tempéraments, leurs mœurs et coutumes.
Aussi, les droits de l’homme semblent-ils vraiment universels seulement dans leur appellation alors que leur contenu est idéologiquement et culturellement conditionné ? S’ils ont vocation à l’universalité, les droits humains sont fortement soumis à une « contextualisation », à une culturalité. Cette culturalité des droits humains se manifeste à travers la diversité, voire la contradiction, de leurs sources idéologiques, de leurs sources textuelles internationales ou régionales, de leurs générations, de leurs particularités géographiques et des rôles, abstentionniste ou interventionniste, qu’ils assignent à l’Etat.
Ainsi, les occidentaux insistent sur les droits civils et politiques, les pays socialistes sur les droits économiques (aux Etats Unis les républicains veulent abroger la réforme socialisante de Obama le démocrate), les Africains affirment les droits des peuples face aux droits individualistes des occidentaux, les Etat arabo-musulmans insistent encore sur l’imprégnation du religieux (de la sharia) dans l’affirmation des droits humains, alors que l’évocation de Dieu suscite des controverses dans les textes fondateurs de l’union Européenne, etc. Concernant les Chinois, Malumalu écrit : « Fidèles à leur culture traditionnelle, les chinois font partie des peuples qui récusent la vision occidentale des droits de l’homme. La notion de liberté individuelle – pour ne prendre que cet exemple – est tout à fait étrangère à la mentalité chinoise qui considère que l’individu n’existe qu’en fonction de la collectivité à laquelle il appartient. » L’acceptation de la culturalité des droits humains n’est pas sans intérêt pour leur effectivité et pour leur revendication administrative et judiciaire. Car une administration ou une juridiction sera d’autant plus sensible à un droit si son contexte culturel y est plus ou moins fortement attaché. Ainsi, il n’est pas rare de voir, en Afrique, les droits reconnus par des textes de droit positif être sacrifiés sur l’autel de la coutume.
En définitive, la seule affirmation de l’universalité des droits humains ne suffit pas à les rendre universels. L’universalité des droits humains reste virtuelle, putative. Elle est soumise aux aléas des cultures, des lieux, des niveaux de développement économique et technologique, des temps et des valeurs. Autant dire que les droits humains n’ont d’universel que le vocable qui les désigne et leur violation
Abstract
Since the universal declaration of the human rights on 10th December 1948, the human rights have come out of their national portray to pretend to universality. In fact, till this date, the human rights were especially object of affirmation and defence by the national texts. The universality of human rights has suscitized living criticisms, in Europe as in the other parts of the world, which have not only adopted them, but also adapted to the sociocultural realities. In adopting the regional and sub-regional texts, the non-European countries have bring back the human rights to their manner of seeing, in continuity with their ideologies, their autochton values, their traditions, their economies, their behaviors and customs.
Also, the human rights, do they really seem only universal in their appellation yet their content ideolologically and culturally conditioned? If they have vocation to universality, human rights are strongly submitted to a « contextualization », to « a culturality ». This culturality of human right is manifested through the diversity, even the contradiction, of their ideological sources, of their regional or international textual sources, of their generations, of their geographical particularities and roles, abstentionist or interventionist, that they assign to the State.
Thus, Europeans insist on the civil and political rights, the socialist countries on the economical rights (in the United States the Republicans want to clean out the socializing reform of Obama the democrat), Africans affirm the rights of people face to the individualist rights of Europeans, the arabo-muslim States insist again on the impregnation of the religions (of the Sharia) in the affirmation of human rights, whereas the evocation of God suscitizes controversies in the founding texts of the European Union, etc. Concerning the Chinese, Malumalu writes : « Faithful to their traditional culture, Chinese are part of people who recuse the occidental vision of human rights. The notion of individual liberty-for not taking only this example-is then stranger to the Chinese mentality which considers that the individual exists in function of collectivity to which it belongs ». The acceptance of culturality of human right is not without interest for their effectivity and for their administrative and judiciary revendication. Because an administration or a jurisdiction will be more or less strongly attached. Thus, it is not rare to see, in Africa, the rights recognized by the texts of positive right be sacrificed on the altar of the custom.
In definitive, the only affirmation of universality of human rights is not enough to render them universal. The universality of human rights stays virtual, putative. It is submitted to constraints of cultures, areas, levels of economic and technological development, times and values. Saying that the human rights have the universal in the word that designates them and their violation.
Téléchargements
Références
ARDANT, Ph., Droit constitutionnel & Institutions politiques, Paris, LGDJ, 1995.
AUBY, J.-M. et AUBY, J.-B., Droit public. Droit constitutionnel, Libertés publiques, Droit administratif, Paris, Editions Sirey.12ème, 1996.
DUPUY, P.-M., Droit international public, Paris, Dalloz, 2006.
FAVOREU, L. et alii, Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2000.
GENEREUX, Jacques, L’économie politique. Analyse économique des choix publics et de la vie politique, Paris, Larousse Bordas, 1996.
GUILLAUME-HOFNUNG, M., La médiation. (Coll. Que sais-je ?, n°2930), Paris, PUF, 1995.
http://www.wikipedia.org/wiki/droits de l’homme. 2/09/2008
IBRAHIMA FALL, Préface à MUTOY MUBIALA, Le système régional africain de protection des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2005.
JEAN-PAUL II, Message pour la célébration de la journée mondiale de la paix, 1er janvier 1999.
KEBA MBAYE, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Editions A. Pedone, 1992.
MALUMALU Muholongue, Apollinaire, Les droits de l’homme à l’épreuve de l’universalité. Perspectives africaines, Projet de publication, 2009.
MARX, Karl, La question juive, Paris, Aubier, 1997.
MONTESQUIEU, L’Esprit des lois, XI, VI.
MOUGNOTTE, A., Eduquer à la démocratie, Paris, Cerf, 1994.
MUTOY MUBIALA, Le système régional africain de protection des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2005.
ROBERT, J. et DUFFAR, J., Droits de l’homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 1999.
TURPIN, Dominique, Les libertés publiques et droits fondamentaux, Paris, Seuil, 2004.
TZITZIS, S., ‘‘Droits de l’homme et droit humanitaire. Mythe ou réalité », dans H. PAILLARD et TZITZIS, S., Droits fondamentaux et spécificités culturelles, Paris, L’Harmattan, 1997.
WACHSMANN, Patrich, Libertés publiques, Paris, Dalloz, 1998.
WACHSMANN, Patrick, Les droits de l’homme, 4ème édition, Dalloz, Paris, 2002.